Spe Salvi
La vie éternelle - qu’est-ce que c’est ?
10. Jusqu’à présent, nous avons parlé de la foi et de l’espérance dans le Nouveau Testament et aux origines du christianisme ; il a cependant toujours été évident que nous ne parlons pas uniquement du passé ; la réflexion dans son intégralité intéresse la vie et la mort de l’homme en général, et donc nous intéresse nous aussi, ici et maintenant. Cependant, nous devons à présent nous demander de manière explicite : la foi chrétienne est-elle aussi pour nous aujourd’hui une espérance qui transforme et soutient notre vie ? Est-elle pour nous « performative » - un message qui forme de manière nouvelle la vie elle-même, ou est-elle désormais simplement une « information » que, entre temps, nous avons mise de côté et qui nous semble dépassée par des informations plus récentes ? Dans la recherche d’une réponse, je voudrais partir de la forme classique du dialogue par lequel le rite du Baptême exprimait l’accueil du nouveau-né dans la communauté des croyants et sa renaissance dans le Christ. Le prêtre demandait d’abord quel nom les parents avaient choisi pour l’enfant, et il poursuivait ensuite par la question : « Que demandez-vous à l’Église ? » Réponse : « La foi ». « Et que donne la foi ? » « La vie éternelle ». Dans le dialogue, les parents cherchaient pour leur enfant l’accès à la foi, la communion avec les croyants, parce qu’ils voyaient dans la foi la clé de « la vie éternelle ». En fait, aujourd’hui comme hier, c’est de cela dont il s’agit dans le Baptême, quand on devient chrétien : non seulement d’un acte de socialisation dans la communauté, non pas simplement d’un accueil dans l’Église. Les parents attendent plus pour le baptisé : ils attendent que la foi, dont fait partie la corporéité de l’Église et de ses sacrements, lui donne la vie - la vie éternelle. La foi est la substance de l’espérance. Mais alors se fait jour la question suivante : voulons-nous vraiment cela - vivre éternellement ? Peut-être aujourd’hui de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais la vie présente, et la foi en la vie éternelle semble, dans ce but, plutôt un obstacle. Continuer à vivre éternellement - sans fin - apparaît plus comme une condamnation que comme un don. Certainement on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible. Mais vivre toujours, sans fin - en définitive, cela peut être seulement ennuyeux et en fin de compte insupportable. C’est précisément cela que dit par exemple saint Ambroise, Père de l’Église, dans le discours funèbre pour son frère Saturus : « La mort n’était pas naturelle, mais elle l’est devenue ; car, au commencement, Dieu n’a pas créé la mort ; il nous l’a donnée comme un remède [...] à cause de la transgression ; la vie des hommes commença à être misérable dans le travail quotidien et dans des pleurs insupportables. Il fallait mettre un terme à son malheur, afin que sa mort lui rende ce que sa vie avait perdu. L’immortalité serait un fardeau plutôt qu’un profit, sans le souffle de la grâce ».[6] Auparavant déjà, Ambroise avait dit : « La mort ne doit pas être pleurée, puisqu’elle est cause de salut ».[7]
11. Quel que soit ce que saint Ambroise entendait dire précisément par ces paroles - il est vrai que l’élimination de la mort ou même son renvoi presque illimité mettrait la terre et l’humanité dans une condition impossible et ne serait même pas un bénéfice pour l’individu lui-même. Il y a clairement une contradiction dans notre attitude, qui renvoie à une contradiction intérieure de notre existence elle-même. D’une part, nous ne voulons pas mourir ; surtout celui qui nous aime ne veut pas que nous mourions. D’autre part, nous ne désirons même pas cependant continuer à exister de manière illimitée et même la terre n’a pas été créée dans cette perspective. Alors, que voulons-nous vraiment ? Ce paradoxe de notre propre attitude suscite une question plus profonde : qu’est-ce en réalité que la « vie » ? Et que signifie véritablement « éternité » ? Il y a des moments où nous le percevons tout à coup : oui, ce serait précisément cela - la vraie « vie » - ainsi devrait-elle être. Par comparaison, ce que, dans la vie quotidienne, nous appelons « vie », en vérité ne l’est pas. Dans sa longue lettre sur la prière adressée à Proba, une veuve romaine aisée et mère de trois consuls, Augustin écrivit un jour : dans le fond, nous voulons une seule chose - « la vie bienheureuse », la vie qui est simplement vie, simplement « bonheur ». En fin de compte, nous ne demandons rien d’autre dans la prière. Nous ne marchons vers rien d’autre - c’est de cela seulement dont il s’agit. Mais ensuite, Augustin ajoute aussi : en regardant mieux, nous ne savons pas de fait ce que, en définitive, nous désirons, ce que nous voudrions précisément. Nous ne connaissons pas du tout cette réalité ; même durant les moments où nous pensons pouvoir la toucher, nous ne la rejoignons pas vraiment. « Nous ne savons pas ce que nous devons demander », confesse-t-il avec les mots de saint Paul (Rm 8,26). Nous savons seulement que ce n’est pas cela. Toutefois, dans notre non-savoir, nous savons que cette réalité doit exister. « Il y a donc en nous, pour ainsi dire, une savante ignorance (docta ignorantia) », écrit-il. Nous ne savons pas ce que nous voudrions vraiment ; nous ne connaissons pas cette « vraie vie » ; et cependant, nous savons qu’il doit exister un quelque chose que nous ne connaissons pas et vers lequel nous nous sentons poussés.[8]
12. Je pense qu’Augustin décrivait là de manière très précise et toujours valable la situation essentielle de l’homme, la situation d’où proviennent toutes ses contradictions et toutes ses espérances. Nous désirons en quelque sorte la vie elle-même, la vraie vie, qui n’est même pas touchée par la mort ; mais, en même temps, nous ne connaissons pas ce vers quoi nous nous sentons poussés. Nous ne pouvons pas nous arrêter de nous diriger vers cela et cependant nous savons que tout ce dont nous pouvons faire l’expérience ou que nous pouvons réaliser n’est pas ce à quoi nous aspirons. Cette « chose » inconnue est la véritable « espérance », qui nous pousse et le fait qu’elle soit ignorée est, en même temps, la cause de toutes les désespérances comme aussi de tous les élans positifs ou destructeurs vers le monde authentique et vers l’homme authentique. L’expression « vie éternelle » cherche à donner un nom à cette réalité connue inconnue. Il s’agit nécessairement d’une expression insuffisante, qui crée la confusion. En effet, « éternel » suscite en nous l’idée de l’interminable, et cela nous fait peur ; « vie » nous fait penser à la vie que nous connaissons, que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre et qui est cependant, en même temps, plus faite de fatigue que de satisfaction, de sorte que, tandis que d’un côté nous la désirons, de l’autre nous ne la voulons pas. Nous pouvons seulement chercher à sortir par la pensée de la temporalité dont nous sommes prisonniers et en quelque sorte prévoir que l’éternité n’est pas une succession continue des jours du calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction, dans lequel la totalité nous embrasse et dans lequel nous embrassons la totalité. Il s’agirait du moment de l’immersion dans l’océan de l’amour infini, dans lequel le temps - l’avant et l’après - n’existe plus. Nous pouvons seulement chercher à penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l’immensité de l’être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. C’est ainsi que Jésus l’exprime dans Jean : « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera » (16, 22). Nous devons penser dans ce sens si nous voulons comprendre ce vers quoi tend l’espérance chrétienne, ce que nous attendons par la foi, par notre être avec le Christ.[9]
L’espérance chrétienne est-elle individualiste ?
13. Dans le cours de leur histoire, les chrétiens ont cherché à traduire ce savoir qui ne sait pas en figures représentables, développant des images du « ciel » qui restent toujours éloignées de ce que, précisément, nous connaissons seulement négativement, à travers une non-connaissance. Toutes ces tentatives de représentation de l’espérance ont donné à de nombreuses personnes, au fil des siècles, l’élan pour vivre en se fondant sur la foi et en abandonnant aussi, de ce fait, leurs « hyparchonta », les substances matérielles pour leur existence. L’auteur de la Lettre aux Hébreux, dans le onzième chapitre, a tracé une sorte d’histoire de ceux qui vivent dans l’espérance et du fait qu’ils sont en marche, une histoire qui va d’Abel à son époque. À l’époque moderne, une critique toujours plus dure de cette sorte d’espérance s’est développée : il s’agirait d’un pur individualisme, qui aurait abandonné le monde à sa misère et qui se serait réfugié dans un salut éternel uniquement privé. Dans l’introduction à son œuvre fondamentale « Catholicisme. Aspects sociaux du dogme », Henri de Lubac a recueilli certaines opinions de ce genre, qui méritent d’être citées : « Ai-je trouvé la joie ? Non [...]. J’ai trouvé ma joie. Et c’est terriblement autre chose [...]. La joie de Jésus peut être personnelle. Elle peut appartenir à un seul homme, et il est sauvé. Il est en paix [...] pour maintenant et pour toujours, mais seul. Cette solitude de joie ne l’inquiète pas, au contraire : il est l’élu. Dans sa béatitude, il traverse les batailles une rose à la main ».[10]
14. Face à cela, de Lubac, en se fondant sur la théologie des Pères dans toute son ampleur, a pu montrer que le salut a toujours été considéré comme une réalité communautaire. La Lettre aux Hébreux parle d’une « cité » (cf. 11, 10.16 ; 12, 22 ; 13, 14) et donc d’un salut communautaire. De manière cohérente, le péché est compris par les Pères comme destruction de l’unité du genre humain, comme fragmentation et division. Babel, le lieu de la confusion des langues et de la séparation, se révèle comme expression de ce que, fondamentalement, est le péché. Et ainsi, la « rédemption » apparaît vraiment comme le rétablissement de l’unité, où nous nous retrouvons de nouveau ensemble, dans une union qui se profile dans la communauté mondiale des croyants. Il n’est pas nécessaire que nous nous occupions ici de tous les textes dans lesquels apparaît le caractère communautaire de l’espérance. Restons dans la Lettre à Proba, où Augustin tente d’illustrer un peu cette réalité connue inconnue dont nous sommes à la recherche. Le point de départ est simplement l’expression « vie bienheureuse ». Puis il cite le Psaume 144 [143], 15 : « Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». Et il continue : « Pour faire partie de ce peuple et que nous puissions parvenir [...] à vivre avec Dieu pour toujours, “le but du précepte, c’est l’amour qui vient d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère” (1 Tm 1, 5) ».[11] Cette vie véritable, vers laquelle nous cherchons toujours de nouveau à tendre, est liée à l’être dans l’union existentielle avec un « peuple » et, pour toute personne, elle ne peut se réaliser qu’à l’intérieur de ce « nous ». Elle présuppose donc l’exode de la prison de son propre « moi », parce que c’est seulement dans l’ouverture de ce sujet universel que s’ouvre aussi le regard sur la source de la joie, sur l’amour lui-même - sur Dieu.
15. Cette vision de la « vie bienheureuse » orientée vers la communauté vise en fait quelque chose au delà du monde présent, mais c’est précisément ainsi qu’elle a aussi à voir avec l’édification du monde - en des formes très diverses, selon le contexte historique et les possibilités offertes ou exclues par lui. Au temps d’Augustin, lorsque l’irruption de nouveaux peuples menaçait la cohésion du monde, où était donnée une certaine garantie de droit et de vie dans une communauté juridique, il s’agissait de fortifier le fondement véritablement porteur de cette communauté de vie et de paix, afin de pouvoir survivre au milieu des mutations du monde. Jetons plutôt au hasard un regard sur un moment du Moyen-Âge selon certains aspects emblématiques. Dans la conscience commune, les monastères apparaissaient comme des lieux de fuite hors du monde (« contemptus mundi ») et de dérobade à ses responsabilités dans le monde, pour la recherche de son salut personnel. Bernard de Clairvaux, qui, avec son Ordre réformé, fit rentrer une multitude de jeunes dans les monastères, avait sur cette question une vision bien différente. Selon lui, les moines ont une tâche pour toute l’Église et par conséquent aussi pour le monde. Par de nombreuses images, il illustre la responsabilité des moines pour tout l’organisme de l’Église, plus encore, pour l’humanité ; il leur applique la parole du Pseudo-Ruffin : « Le genre humain vit grâce à peu de gens ; s’ils n’existaient pas, le monde périrait ».[12] Les contemplatifs - contemplantes - doivent devenir des travailleurs agricoles - laborantes -, nous dit-il. La noblesse du travail, que le christianisme a héritée du judaïsme, était apparue déjà dans les règles monastiques d’Augustin et de Benoît. Bernard reprend à nouveau ce concept. Les jeunes nobles qui affluaient dans ses monastères devaient se plier au travail manuel. En vérité, Bernard dit explicitement que pas même le monastère ne peut rétablir le Paradis ; il soutient cependant qu’il doit, presque comme lieu de défrichage pratique et spirituel, préparer le nouveau Paradis. Un terrain sauvage est rendu fertile - précisément tandis que sont en même temps abattus les arbres de l’orgueil, qu’est enlevé ce qui pousse de sauvage dans les âmes et qu’est préparé ainsi le terrain sur lequel peut prospérer le pain pour le corps et pour l’âme.[13] Ne nous est-il pas donné de constater de nouveau, justement face à l’histoire actuelle, qu’aucune structuration positive du monde ne peut réussir là où les âmes restent à l’état sauvage ?
La transformation de la foi-espérance chrétienne dans les temps modernes
16. Comment l’idée que le message de Jésus est strictement individualiste et qu’il s’adresse seulement à l’individu a-t-elle pu se développer ? Comment est-on arrivé à interpréter le « salut de l’âme » comme une fuite devant la responsabilité pour l’ensemble et à considérer par conséquent que le programme du christianisme est la recherche égoïste du salut qui se refuse au service des autres ? Pour trouver une réponse à ces interrogations, nous devons jeter un regard sur les composantes fondamentales des temps modernes. Elles apparaissent avec une clarté particulière chez Francis Bacon. Qu’une nouvelle époque soit née - grâce à la découverte de l’Amérique et aux nouvelles conquêtes techniques qui ont marqué ce développement -, c’est indiscutable. Cependant, sur quoi s’enracine ce tournant d’une époque ? C’est la nouvelle corrélation entre expérience et méthode qui met l’homme en mesure de parvenir à une interprétation de la nature conforme à ses lois et d’arriver ainsi, en définitive, à « la victoire de l’art sur la nature » (victoria cursus artis super naturam).[14] La nouveauté - selon la vision de Bacon - se trouve dans une nouvelle corrélation entre science et pratique. Cela est ensuite appliqué aussi à la théologie : cette nouvelle corrélation entre science et pratique signifierait que la domination sur la création, donnée à l’homme par Dieu et perdue par le péché originel, serait rétablie.[15]
17. Celui qui lit ces affirmations et qui y réfléchit avec attention y rencontre un passage déconcertant : jusqu’à ce moment, la récupération de ce que l’homme, dans l’exclusion du paradis terrestre, avait perdu était à attendre de la foi en Jésus Christ, et en cela se voyait la « rédemption ». Maintenant, cette « rédemption », la restauration du « paradis » perdu, n’est plus à attendre de la foi, mais de la relation à peine découverte entre science et pratique. Ce n’est pas que la foi, avec cela, fut simplement niée : elle était plutôt déplacée à un autre niveau - le niveau strictement privé et ultra-terrestre - et, en même temps, elle devient en quelque sorte insignifiante pour le monde. Cette vision programmatique a déterminé le chemin des temps modernes et influence aussi la crise actuelle de la foi qui, concrètement, est surtout une crise de l’espérance chrétienne. Ainsi, l’espérance reçoit également chez Bacon une forme nouvelle. Elle s’appelle désormais foi dans le progrès. Pour Bacon en effet, il est clair que les découvertes et les inventions tout juste lancées sont seulement un début, que, grâce à la synergie des sciences et des pratiques, s’ensuivront des découvertes totalement nouvelles et qu’émergera un monde totalement nouveau, le règne de l’homme.[16] C’est ainsi qu’il a aussi présenté une vision des inventions prévisibles - jusqu’à l’avion et au submersible. Au cours du développement ultérieur de l’idéologie du progrès, la joie pour les avancées visibles des potentialités humaines demeure une constante confirmation de la foi dans le progrès comme tel.
18. Dans le même temps, deux catégories sont toujours davantage au centre de l’idée de progrès : la raison et la liberté. Le progrès est surtout un progrès dans la domination croissante de la raison et cette raison est considérée clairement comme un pouvoir du bien et pour le bien. Le progrès est le dépassement de toutes les dépendances - il est progrès vers la liberté parfaite. La liberté aussi est perçue seulement comme une promesse, dans laquelle l’homme va vers sa plénitude. Dans les deux concepts - liberté et raison - est présent un aspect politique. En effet, le règne de la raison est attendu comme la nouvelle condition de l’humanité devenue totalement libre. Cependant, les conditions politiques d’un tel règne de la raison et de la liberté apparaissent, dans un premier temps, peu définies. Raison et liberté semblent garantir par elles-mêmes, en vertu de leur bonté intrinsèque, une nouvelle communauté humaine parfaite. Néanmoins, dans les deux concepts-clé de « raison » et de « liberté », la pensée est aussi tacitement toujours en opposition avec les liens de la foi et de l’Église comme avec les liens des systèmes d’État d’alors. Les deux concepts portent donc en eux un potentiel révolutionnaire d’une force explosive énorme.
19. Nous devons brièvement jeter un regard sur les deux étapes essentielles de la concrétisation politique de cette espérance, parce qu’elles sont d’une grande importance pour le chemin de l’espérance chrétienne, pour sa compréhension et pour sa persistance. Il y a avant tout la Révolution française comme tentative d’instaurer la domination de la raison et de la liberté, maintenant aussi de manière politiquement réelle. L’Europe de l’Illuminisme, dans un premier temps, s’est tournée avec fascination vers ces événements, mais face à leurs développements, elle a dû ensuite réfléchir de manière renouvelée sur la raison et la liberté. Les deux écrits d’Emmanuel Kant, où il réfléchit sur les événements, sont significatifs pour les deux phases de la réception de ce qui était survenu en France. En 1792, il écrit son œuvre : « Der Sieg des guten Prinzips über das böse und die Gründung eines Reiches Gottes auf Erden » (La victoire du principe du bien sur le principe mauvais et la constitution d’un règne de Dieu sur la terre). Il y écrit : « Le passage progressif de la foi d’Église à l’autorité unique de la pure foi religieuse est l’approche du royaume de Dieu ».[17] Il nous dit aussi que les révolutions peuvent accélérer les temps de ce passage de la foi d’Église à la foi rationnelle. Le « règne de Dieu », dont Jésus avait parlé, a reçu là une nouvelle définition et a aussi pris une nouvelle présence ; il existe, pour ainsi dire, une nouvelle « attente immédiate » : le « règne de Dieu » arrive là où la foi d’Église est dépassée et remplacée par la « foi religieuse », à savoir par la simple foi rationnelle. En 1795, dans l’écrit « Das Ende aller Dinge » (La fin de toutes les choses), apparaît une image transformée. Kant prend alors en considération la possibilité que, à côté du terme naturel de toutes les choses, il s’en trouve aussi une contre nature, perverse. Il écrit à ce sujet : « Si le christianisme devait cesser d’être aimable [...], on verrait nécessairement [...] l’aversion et la révolte soulever contre lui le cœur de la majorité des hommes ; et l’antéchrist, qu’on considère de toute façon comme le précurseur du dernier jour, établirait son règne (fondé sans doute sur la peur et l’égoïsme), fût-ce pour peu de temps ; et comme le christianisme, destiné à être la religion universelle, serait alors frustré de la faveur du destin, on assisterait à la fin (renversée) de toutes choses au point de vue moral ».[18]
20. Le dix-neuvième siècle ne renia pas sa foi dans le progrès comme forme de l’espérance humaine et il continua à considérer la raison et la liberté comme des étoiles-guide à suivre sur le chemin de l’espérance. Les avancées toujours plus rapides du développement technique et l’industrialisation qui lui est liée ont cependant bien vite créé une situation sociale totalement nouvelle : il s’est formé la classe des ouvriers de l’industrie et ce que l’on appelle le « prolétariat industriel », dont les terribles conditions de vie ont été illustrées de manière bouleversante par Friedrich Engels, en 1845. Pour le lecteur, il devait être clair que cela ne pouvait pas continuer ; un changement était nécessaire. Mais le changement aurait perturbé et renversé l’ensemble de la structure de la société bourgeoise. Après la révolution bourgeoise de 1789, l’heure d’une nouvelle révolution avait sonné, la révolution prolétarienne : le progrès ne pouvait pas simplement avancer de manière linéaire, à petits pas. Il fallait un saut révolutionnaire. Karl Marx recueillit cette aspiration du moment et, avec un langage et une pensée vigoureux, il chercha à lancer ce grand pas nouveau et, comme il le considérait, définitif de l’histoire vers le salut - vers ce que Kant avait qualifié de « règne de Dieu ». Une fois que la vérité de l’au-delà se serait dissipé, il se serait agi désormais d’établir la vérité de l’en deçà. La critique du ciel se transforme en une critique de la terre, la critique de la théologie en une critique de la politique. Le progrès vers le mieux, vers le monde définitivement bon, ne provient pas simplement de la science, mais de la politique - d’une politique pensée scientifiquement, qui sait reconnaître la structure de l’histoire et de la société, et qui indique ainsi la voie vers la révolution, vers le changement de toutes les choses. Avec précision, même si c’est de manière unilatérale et partiale, Marx a décrit la situation de son temps et il a illustré avec une grande capacité d’analyse les voies qui ouvrent à la révolution - non seulement théoriquement : avec le parti communiste, né du manifeste communiste de 1848, il l’a aussi lancée concrètement. Sa promesse, grâce à la précision des analyses et aux indications claires des instruments pour le changement radical, a fasciné et fascine encore toujours de nouveau. La révolution s’est aussi vérifiée de manière plus radicale en Russie.
21. Mais avec sa victoire, l’erreur fondamentale de Marx a aussi été rendue évidente. Il a indiqué avec exactitude comment réaliser le renversement. Mais il ne nous a pas dit comment les choses auraient dû se dérouler après. Il supposait simplement que, avec l’expropriation de la classe dominante, avec la chute du pouvoir politique et avec la socialisation des moyens de production, se serait réalisée la Nouvelle Jérusalem : alors, toutes les contradictions auraient en effet été annulées, l’homme et le monde auraient finalement vu clair en eux-mêmes. Alors tout aurait pu procéder de soi-même sur la voie droite, parce que tout aurait appartenu à tous et que tous auraient voulu le meilleur les uns pour les autres. Ainsi, après la révolution réussie, Lénine dut se rendre compte que, dans les écrits du maître, il ne se trouvait aucune indication sur la façon de procéder. Oui, il avait parlé de la phase intermédiaire de la dictature du prolétariat comme d’une nécessité qui, cependant, dans un deuxième temps, se serait avérée d’elle-même caduque. Cette « phase intermédiaire », nous la connaissons bien et nous savons aussi comment elle s’est développée, ne faisant pas naître un monde sain, mais laissant derrière elle une destruction désolante. Marx n’a pas seulement manqué de penser les institutions nécessaires pour le nouveau monde - on ne devait en effet plus en avoir besoin. Qu’il ne nous en dise rien, c’est la conséquence logique de sa mise en place. Son erreur est plus en profondeur. Il a oublié que l’homme demeure toujours homme. Il a oublié l’homme et il a oublié sa liberté. Il a oublié que la liberté demeure toujours liberté, même pour le mal. Il croyait que, une fois mise en place l’économie, tout aurait été mis en place. Sa véritable erreur est le matérialisme : en effet, l’homme n’est pas seulement le produit de conditions économiques, et il n’est pas possible de le guérir uniquement de l’extérieur, créant des conditions économiques favorables.
22. Ainsi, nous nous trouvons de nouveau devant la question : que pouvons-nous espérer ? Une autocritique de l’ère moderne dans un dialogue avec le christianisme et avec sa conception de l’espérance est nécessaire. Dans un tel dialogue, même les chrétiens, dans le contexte de leurs connaissances et de leurs expériences, doivent apprendre de manière renouvelée en quoi consiste véritablement leur espérance, ce qu’ils ont à offrir au monde et ce que, à l’inverse, ils ne peuvent pas offrir. Il convient que, à l’autocritique de l’ère moderne, soit associée aussi une autocritique du christianisme moderne, qui doit toujours de nouveau apprendre à se comprendre lui-même à partir de ses propres racines. Sur ce point, on peut seulement présenter ici certains éléments. Avant tout, il faut se demander : que signifie vraiment « le progrès » ; que promet-il et que ne promet-il pas ? Déjà à la fin du XIXe siècle, il existait une critique de la foi dans le progrès. Au XXe, Th. W. Adorno a formulé la problématique de la foi dans le progrès de manière drastique : le progrès, vu de près, serait le progrès qui va de la fronde à la mégabombe. Actuellement, il s’agit, de fait, d’un aspect du progrès que l’on ne doit pas dissimuler. Pour le dire autrement, l’ambiguïté du progrès est rendue évidente. Sans aucun doute, le progrès offre de nouvelles possibilités pour le bien, mais il ouvre aussi des possibilités abyssales de mal - possibilités qui n’existaient pas auparavant. Nous sommes tous devenus témoins de ce que le progrès, lorsqu’il est entre de mauvaises mains, peut devenir, et qu’il est devenu, de fait, un progrès terrible dans le mal. Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l’homme, dans la croissance de l’homme intérieur (cf. Ep 3,16 ; 2 Co 4, 16), alors ce n’est pas un progrès, mais une menace pour l’homme et pour le monde.
23. En ce qui concerne les deux grands thèmes « raison » et « liberté », les questions qui leur sont liées ne peuvent être ici que signalées. Oui, la raison est le grand don de Dieu à l’homme, et la victoire de la raison sur l’irrationalité est aussi un but de la foi chrétienne. Mais quand la raison domine-t-elle vraiment ? Quand s’est-elle détachée de Dieu ? Quand est-elle devenue aveugle pour Dieu ? La raison du pouvoir et du faire est-elle déjà la raison intégrale ? Si, pour être progrès, le progrès a besoin de la croissance morale de l’humanité, alors la raison du pouvoir et du faire doit pareillement, de manière urgente, être intégrée, grâce à l’ouverture de la raison, aux forces salvifiques de la foi, au discernement entre bien et mal. C’est ainsi seulement qu’elle devient une raison vraiment humaine. Elle devient humaine seulement si elle est en mesure d’indiquer la route à la volonté, et elle n’est capable de cela que si elle regarde au delà d’elle-même. Dans le cas contraire, la situation de l’homme, dans le déséquilibre entre capacité matérielle et manque de jugement du cœur, devient une menace pour lui et pour tout le créé. Ainsi, dans le domaine de la liberté, il faut se rappeler que la liberté humaine requiert toujours le concours de différentes libertés. Ce concours ne peut toutefois pas réussir s’il n’est pas déterminé par un intrinsèque critère de mesure commun, qui est le fondement et le but de notre liberté. Exprimons-le maintenant de manière très simple : l’homme a besoin de Dieu, autrement, il reste privé d’espérance. Étant donné les développements de l’ère moderne, l’affirmation de saint Paul citée au début (Ep 2,12) se révèle très réaliste et tout simplement vraie. Il n’y a cependant pas de doute qu’un « règne de Dieu » réalisé sans Dieu - donc un règne de l’homme seul - finit inévitablement avec « l’issue perverse » de toutes les choses, issue décrite par Kant : nous l’avons vu et nous le voyons toujours de nouveau. Et il n’y a même pas de doute que Dieu entre vraiment dans les choses humaines seulement s’il n’est pas uniquement pensé par nous, mais si Lui-même vient à notre rencontre et nous parle. C’est pourquoi la raison a besoin de la foi pour arriver à être totalement elle-même : raison et foi ont besoin l’une de l’autre pour réaliser leur véritable nature et leur mission.
La vraie physionomie de l’espérance chrétienne
24. Demandons-nous maintenant de nouveau : que pouvons-nous espérer ? Et que ne pouvons-nous pas espérer ? Avant tout nous devons constater qu’un progrès qui se peut additionner n’est possible que dans le domaine matériel. Ici, dans la connaissance croissante des structures de la matière et en relation avec les inventions toujours plus avancées, on note clairement une continuité du progrès vers une maîtrise toujours plus grande de la nature. À l’inverse, dans le domaine de la conscience éthique et de la décision morale, il n’y a pas de possibilité équivalente d’additionner, pour la simple raison que la liberté de l’homme est toujours nouvelle et qu’elle doit toujours prendre à nouveau ses décisions. Elles ne sont jamais simplement déjà prises pour nous par d’autres - dans un tel cas, en effet, nous ne serions plus libres. La liberté présuppose que, dans les décisions fondamentales, tout homme, chaque génération, est un nouveau commencement. Les nouvelles générations peuvent assurément construire sur la connaissance et sur les expériences de celles qui les ont précédées, comme elles peuvent puiser au trésor moral de l’humanité entière. Mais elles peuvent aussi le refuser, parce que ce trésor ne peut pas avoir la même évidence que les inventions matérielles. Le trésor moral de l’humanité n’est pas présent comme sont présents les instruments que l’on utilise ; il existe comme invitation à la liberté et comme possibilité pour cette liberté. Mais cela signifie que :
a) La condition droite des choses humaines, le bien-être moral du monde, ne peuvent jamais être garantis simplement par des structures, quelle que soit leur validité. De telles structures sont non seulement importantes, mais nécessaires ; néanmoins, elles ne peuvent pas et ne doivent pas mettre hors jeu la liberté de l’homme. Même les structures les meilleures fonctionnent seulement si, dans une communauté, sont vivantes les convictions capables de motiver les hommes en vue d’une libre adhésion à l’ordonnancement communautaire. La liberté nécessite une conviction ; une conviction n’existe pas en soi, mais elle doit être toujours de nouveau reconquise de manière communautaire.
b) Puisque l’homme demeure toujours libre et que sa liberté est également toujours fragile, le règne du bien définitivement consolidé n’existera jamais en ce monde. Celui qui promet le monde meilleur qui durerait irrévocablement pour toujours fait une fausse promesse ; il ignore la liberté humaine. La liberté doit toujours de nouveau être conquise pour le bien. La libre adhésion au bien n’existe jamais simplement en soi. S’il y avait des structures qui fixaient de manière irrévocable une condition du monde déterminée - bonne -, la liberté de l’homme serait niée, et, pour cette raison, ce ne serait en définitive nullement des structures bonnes.
25. La conséquence de ce qui a été dit est que la recherche pénible et toujours nouvelle d’ordonnancements droits pour les choses humaines est le devoir de chaque génération ; ce n’est jamais un devoir simplement accompli. Toutefois, chaque génération doit aussi apporter sa propre contribution pour établir des ordonnancements convaincants de liberté et de bien, qui aident la génération suivante en tant qu’orientation pour l’usage droit de la liberté humaine et qui donnent ainsi, toujours dans les limites humaines, une garantie assurée, même pour l’avenir. Autrement dit : les bonnes structures aident, mais, à elles seules, elles ne suffisent pas. L’homme ne peut jamais être racheté simplement de l’extérieur. Francis Bacon et les adeptes du courant de pensée de l’ère moderne qu’il a inspiré, en considérant que l’homme serait racheté par la science, se trompaient. Par une telle attente, on demande trop à la science ; cette sorte d’espérance est fallacieuse. La science peut contribuer beaucoup à l’humanisation du monde et de l’humanité. Cependant, elle peut aussi détruire l’homme et le monde, si elle n’est pas orientée par des forces qui se trouvent hors d’elle. D’autre part, nous devons aussi constater que le christianisme moderne, face aux succès de la science dans la structuration progressive du monde, ne s’était en grande partie concentré que sur l’individu et sur son salut. Par là, il a restreint l’horizon de son espérance et n’a même pas reconnu suffisamment la grandeur de sa tâche, même si ce qu’il a continué à faire pour la formation de l’homme et pour le soin des plus faibles et des personnes qui souffrent reste important.
26. Ce n’est pas la science qui rachète l’homme. L’homme est racheté par l’amour. Cela vaut déjà dans le domaine purement humain. Lorsque quelqu’un, dans sa vie, fait l’expérience d’un grand amour, il s’agit d’un moment de « rédemption » qui donne un sens nouveau à sa vie. Mais, très rapidement, il se rendra compte que l’amour qui lui a été donné ne résout pas, par lui seul, le problème de sa vie. Il s’agit d’un amour qui demeure fragile. Il peut être détruit par la mort. L’être humain a besoin de l’amour inconditionnel. Il a besoin de la certitude qui lui fait dire : « Ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ » (Rm 8,38-39). Si cet amour absolu existe, avec une certitude absolue, alors - et seulement alors - l’homme est « racheté », quel que soit ce qui lui arrive dans un cas particulier. C’est ce que l’on entend lorsque l’on dit : Jésus Christ nous a « rachetés ». Par lui nous sommes devenus certains de Dieu - d’un Dieu qui ne constitue pas une lointaine « cause première » du monde - parce que son Fils unique s’est fait homme et de lui chacun peut dire : « Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi » (Ga 2,20).
27. En ce sens, il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l’existence (cf. Ep 2,12). La vraie, la grande espérance de l’homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu - le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours « jusqu’au bout », « jusqu’à ce que tout soit accompli » (cf. Jn 13,1 et 19, 30). Celui qui est touché par l’amour commence à comprendre ce qui serait précisément « vie ». Il commence à comprendre ce que veut dire la parole d’espérance que nous avons rencontrée dans le rite du Baptême : de la foi j’attends la « vie éternelle » - la vie véritable qui, totalement et sans menaces, est, dans toute sa plénitude, simplement la vie. Jésus, qui a dit de lui-même être venu pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en plénitude, en abondance (cf. Jn 10,10), nous a aussi expliqué ce que signifie « la vie » : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn 17,3). La vie dans le sens véritable, on ne l’a pas en soi, de soi tout seul et pas même seulement par soi : elle est une relation. Et la vie dans sa totalité est relation avec Celui qui est la source de la vie. Si nous sommes en relation avec Celui qui ne meurt pas, qui est Lui-même la Vie et l’Amour, alors nous sommes dans la vie. Alors « nous vivons ».
28. Mais maintenant se pose la question : de cette façon ne sommes-nous pas, peut-être, retombés de nouveau dans l’individualisme du salut ? Dans l’espérance seulement pour moi, qui justement n’est pas une véritable espérance, pourquoi oublie-t-elle et néglige-t-elle les autres ? Non. La relation avec Dieu s’établit par la communion avec Jésus - seuls et avec nos seules possibilités nous n’y arrivons pas. La relation avec Jésus, cependant, est une relation avec Celui qui s’est donné lui-même en rançon pour nous tous (cf. 1 Tm 2, 6). Le fait d’être en communion avec Jésus Christ nous implique dans son être « pour tous », il en fait notre façon d’être. Il nous engage pour les autres, mais c’est seulement dans la communion avec Lui qu’il nous devient possible d’être vraiment pour les autres, pour l’ensemble. Je voudrais, dans ce contexte, citer le grand docteur grec de l’Église, saint Maxime le Confesseur (mort en 662), qui tout d’abord exhorte à ne rien placer avant la connaissance et l’amour de Dieu, mais qui ensuite arrive aussitôt à des applications très pratiques : « Qui aime Dieu aime aussi son prochain sans réserve. Bien incapable de garder ses richesses, il les dispense comme Dieu, fournissant à chacun ce dont il a besoin ».[19] De l’amour envers Dieu découle la participation à la justice et à la bonté de Dieu envers autrui ; aimer Dieu demande la liberté intérieure face à toute possession et à toutes les choses matérielles : l’amour de Dieu se révèle dans la responsabilité envers autrui.[20] Nous pouvons observer de façon touchante la même relation entre amour de Dieu et responsabilité envers les hommes dans la vie de saint Augustin. Après sa conversion à la foi chrétienne, avec quelques amis aux idées semblables, il voulait mener une vie qui fût totalement consacrée à la parole de Dieu et aux choses éternelles. Il voulait réaliser par des valeurs chrétiennes l’idéal de la vie contemplative exprimé dans la grande philosophie grecque, choisissant de cette façon « la meilleure part » (cf. Lc 10,42). Mais les choses en allèrent autrement. Alors qu’il participait à la messe dominicale dans la ville portuaire d’Hippone, il fut appelé hors de la foule par l’Évêque et contraint à se laisser ordonner pour l’exercice du ministère sacerdotal dans cette ville. Jetant un regard rétrospectif sur ce moment il écrit dans ses Confessions : « Atterré par mes péchés et la masse pesante de ma misère, j’avais, en mon cœur, agité et ourdi le projet de fuir dans la solitude : mais tu m’en as empêché, et tu m’as fortifié par ces paroles : “Le Christ est mort pour tous afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux” (2 Co 5, 15) ».[21] Le Christ est mort pour tous. Vivre pour Lui signifie se laisser associer à son « être pour ».
29. Pour Augustin, cela signifiait une vie totalement nouvelle. Une fois, il décrivit ainsi son quotidien : « Corriger les indisciplinés, conforter les pusillanimes, soutenir les faibles, réfuter les opposants, se garder des mauvais, instruire les ignorants, stimuler les négligents, freiner les querelleurs, modérer les ambitieux, encourager les découragés, pacifier les adversaires, aider les personnes dans le besoin, libérer les opprimés, montrer son approbation aux bons, tolérer les mauvais et [hélas] aimer tout le monde ».[22] « C’est l’Évangile qui m’effraie » [23] - cette crainte salutaire qui nous empêche de vivre pour nous-mêmes et qui nous pousse à transmettre notre commune espérance. De fait, c’était bien l’intention d’Augustin : dans la situation difficile de l’empire romain, qui menaçait aussi l’Afrique romaine et qui, à la fin de la vie d’Augustin, la détruisit tout à fait, transmettre une espérance - l’espérance qui lui venait de la foi et qui, en totale contradiction avec son tempérament introverti, le rendit capable de participer de façon résolue et avec toutes ses forces à l’édification de la cité. Dans le même chapitre des Confessions, où nous venons de voir le motif décisif de son engagement « pour tous », il écrit : Le Christ « intercède pour nous, sans lui c’est le désespoir. Elles sont nombreuses, ces langueurs, et si fortes ! Nombreuses et fortes, mais ton remède est plus grand. En croyant que ton Verbe était beaucoup trop loin de s’unir à l’homme, nous aurions bien pu désespérer de nous, s’il ne s’était fait chair, habitant parmi nous ».[24] En raison de son espérance, Augustin s’est dépensé pour les gens simples et pour sa ville - il a renoncé à sa noblesse spirituelle et il a prêché et agi de façon simple pour les gens simples.
30. Résumons ce que nous avons découvert jusqu’à présent au cours de nos réflexions. Tout au long des jours, l’homme a de nombreuses espérances - les plus petites ou les plus grandes -, variées selon les diverses périodes de sa vie. Parfois il peut sembler qu’une de ces espérances le satisfasse totalement et qu’il n’ait pas besoin d’autres espérances. Dans sa jeunesse, ce peut être l’espérance d’un grand amour qui le comble ; l’espérance d’une certaine position dans sa profession, de tel ou tel succès déterminant pour le reste de la vie. Cependant, quand ces espérances se réalisent, il apparaît clairement qu’en réalité ce n’était pas la totalité. Il paraît évident que l’homme a besoin d’une espérance qui va au-delà. Il paraît évident que seul peut lui suffire quelque chose d’infini, quelque chose qui sera toujours plus que ce qu’il ne peut jamais atteindre. En ce sens, les temps modernes ont fait grandir l’espérance de l’instauration d’un monde parfait qui, grâce aux connaissances de la science et à une politique scientifiquement fondée, semblait être devenue réalisable. Ainsi l’espérance biblique du règne de Dieu a été remplacée par l’espérance du règne de l’homme, par l’espérance d’un monde meilleur qui serait le véritable « règne de Dieu ». Cela semblait finalement l’espérance, grande et réaliste, dont l’homme avait besoin. Elle était en mesure de mobiliser - pour un certain temps - toutes les énergies de l’homme ; ce grand objectif semblait mériter tous les engagements. Mais au cours du temps il parut clair que cette espérance s’éloignait toujours plus. On se rendit compte avant tout que c’était peut-être une espérance pour les hommes d’après-demain, mais non une espérance pour moi. Et bien que le « pour tous » fasse partie de la grande espérance - je ne puis en effet devenir heureux contre les autres et sans eux - il reste vrai qu’une espérance qui ne me concerne pas personnellement n’est pas non plus une véritable espérance. Et il est devenu évident qu’il s’agissait d’une espérance contre la liberté, parce que la situation des choses humaines dépend pour chaque génération, de manière renouvelée, de la libre décision des hommes qui la composent. Si, en raison des conditions et des structures, cette liberté leur était enlevée, le monde, en définitive, ne serait pas bon, parce qu’un monde sans liberté n’est en rien un monde bon. Ainsi, bien qu’un engagement continu pour l’amélioration du monde soit nécessaire, le monde meilleur de demain ne peut être le contenu spécifique et suffisant de notre espérance. Et toujours à ce propos se pose la question : Quand le monde est-il « meilleur » ? Qu’est ce qui le rend bon ? Selon quel critère peut-on évaluer le fait qu’il soit bon ? Et par quels chemins peut-on parvenir à cette « bonté » ?
31. Ou encore : nous avons besoin des espérances - des plus petites ou des plus grandes - qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. Précisément, le fait d’être gratifié d’un don fait partie de l’espérance. Dieu est le fondement de l’espérance - non pas n’importe quel dieu, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu’au bout - chacun individuellement et l’humanité tout entière. Son Règne n’est pas un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise jamais ; son règne est présent là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer avec sobriété jour après jour, sans perdre l’élan de l’espérance, dans un monde qui, par nature, est imparfait. Et, en même temps, son amour est pour nous la garantie qu’existe ce que nous pressentons vaguement et que, cependant, nous attendons au plus profond de nous-mêmes : la vie qui est « vraiment » vie. Cherchons maintenant à concrétiser cette idée dans une dernière partie, en portant notre attention sur quelques « lieux » d’apprentissage pratique et d’exercice de l’espérance.
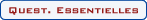





 30 décembre 2025 -
30 décembre 2025 -


